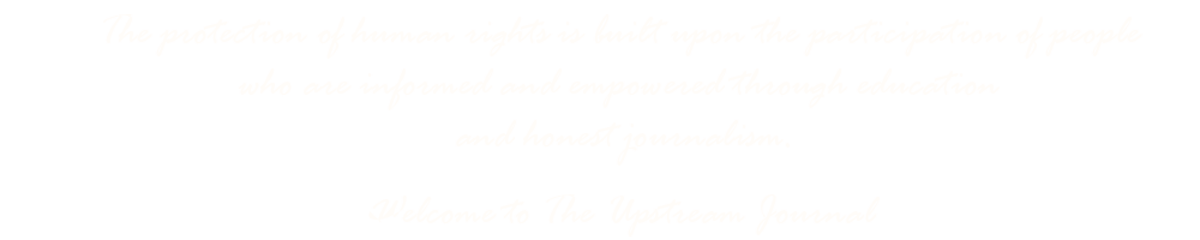Évolution de l’émancipation des femmes marocaines a l’ombre de la Moudawana
Cet article cherche à capturer la complexité du combat féministe au Maroc dans une ère de réforme politique et juridique. Il met d’abord en évidence dans son introduction les défis auxquels les femmes étaient confrontées dans divers domaines de leur vie quotidienne. S’ensuit l’examen du système juridique jetant la lumière sur les lacunes et inégalités persistantes a posteriori des réformes de la Moudawana, un remaniement audacieux de la législation en 2004 pour élever la condition féminine établies en 2011.
L’article ne se concentre pas uniquement sur les problèmes, mais aussi sur les voies novatrices empruntées par les femmes pour obtenir leur émancipation. Il décrit comment la sororité s’est renforcée grâce à l’inclusion professionnelle, la restructuration de l’espace public, l’éducation et l’écriture personnelle. Ces avenues non conventionnelles ont joué un rôle crucial dans le cheminement vers la libération féminine.
Malgré ces progrès, l’article souligne la fragilité et l’incertitude de cette voie vers l’émancipation. L’héritage, l’ambivalence du culte et les défis persistants en matière d’éducation continuent d’affecter les femmes.)
Être une femme au Maroc avec l’arrivée de la Moudawana
Les lacunes du système juridique post-Moudawana
Les voies non-conventionnelles de la libération féminine
La restructuration de l’espace public
La fédération de la sororité à travers l’inclusion professionnelle
L’éducation comme véhicule de tolérance et de clairvoyance
Écrire pour mieux se retrouver
Une voie fragile et incertaine vers l’émancipation
L’ambivalence du culte dans le combat féminin (héritage)
Une éducation en marge
Amina El Filali, une jeune fille marocaine, violée à 15 ans, a été contrainte d’épouser son violeur par les lois du Code Pénal et la pression familiale. Un an plus tard, le 10 mars 2012, elle choisit la seule issue qu’elle pense avoir : le suicide.
Son cas est loin d’être isolé puisque des dizaines d’histoires comme celles-ci émergent chaque année des rues marocaines. Ce qui distingue cependant l’affaire d’Amina, c’est qu’elle a rouvert le débat, avec une ferveur bruyante cette fois, sur les droits des femmes et les dynamiques de genre dans le contexte post-reformes de 2011. Des thèmes brulants – violences domestiques, mariages forcés, gardes arrachées et restrictions sur l’héritage – s’élèvent, brutalisent et interrogent encore les Marocains sur la place qu’ils accordent aux femmes. La majorité politisée ressent ainsi l’urgence de rétablir ou redéfinir les cadres liés à ces problématiques-là.
Cet article traite de l’expérience de précarité et de marginalisation de la femme marocaine ainsi que de l’évolution de son émancipation avec l’arrivée de la Moudawana. À travers une exploration approfondie, voyons les défis qui parsèment leur parcours socialement et politiquement dans ce contexte précis.
Être une femme au Maroc avec l’arrivée de la Moudawana

« Dans le monde arabe, soit la femme est protégée par le patriarche, soit elle ne l’est pas. ». Rita El Khayat, psychiatre, ethno-anthropologue et écrivaine, emploie cette locution pour définir la condition féminine au Maroc et les forces qui la limitent. Elle reflète, à travers ces mots-là, une réalité sociale, politique et juridique selon laquelle être une femme, c’est souvent être sous tutelle. Mineures légales, elle explique que les femmes sont dépendantes du consentement d’un tuteur masculin (qu’il s’agisse du père ou du mari) pour prendre des décisions dans nombreux domaines de leurs vies tels que le mariage, l’occupation, la gestion financière…
Ayant réalisé ces contraintes et ces restrictions à la liberté, des esprits rebelles refusent ce carcan et poussent pour des revendications progressistes. Leur reflet se trouve dans la Moudawana. Le Maroc n’a pas été épargné par les secousses du Printemps arabe, ces rébellions qui ont balayé le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. En réponse, le Roi introduit en 2011 une nouvelle constitution, scellant les évolutions de la Moudawana et proclamant l’égalité des sexes. Là, des progrès concrets se dessinent.
« Aujourd’hui les femmes sont plus libres » proclame-t-on. Après la Moudawana, cette liberté s’étend au travail, à l’éducation, à la mobilité, et même aux négociations matrimoniales. Les cercles politiques et judiciaires accueillent davantage de femmes. Nezha Hayat, à la tête de la Bourse de Casablanca, Badia Skalli au Parlement, ces femmes brisent le plafond de verre.
Pourtant, des ombres persistent. Des histoires, comme celle d’Amina, soulignent des aspects intouchés par les réformes. L’enseignante Houda Folleas-Cadi pointe le conservatisme masculin dans le divorce, la polygamie et la tutelle sur les enfants. Le schéma persiste, défiant le temps. Alors, les lois nouvelles suffisent-elles à honorer la promesse d’égalité de 2011 ? Ou l’héritage patriarcal rejette-t-il ce combat comme vain ?
Les lacunes du système juridique
Khadija El Amrani, avocate spécialisée en droit familial, énonce avec conviction : « La Moudawana à fort heureusement octroyé aux femmes le droit de divorcer, de se marier sans la tutelle paternelle, et de faire hériter leurs enfants si elles viennent à décéder avant leurs parents ».

Pour elle, il est indéniable que cette réforme a comblé d’importantes failles légales, conférant ainsi une protection accrue aux droits des femmes. La Moudawana a particulièrement remodelé les domaines du mariage et du divorce, en reconnaissant plus amplement l’équité entre les sexes et en donnant aux femmes plus d’autonomie dans leur vie personnelle.
Pourtant, nombreux sont ceux qui jugent encore certains aspects de la Moudawana anticonstitutionnels, considérant qu’ils portent atteinte aux libertés fondamentales. Khadija, ayant fait le choix de se consacrer au droit de la famille, explique que « le patriarcat impose des lois qui n’ont plus de sens aujourd’hui, que ce soit d’un point de vue social ou religieux ». Son plaidoyer est clair : « Il est grand temps que la situation des femmes évolue. Nous souffrons à toutes les étapes de nos vies. Nous sommes confrontées à des injustices qui nous rabaissent ».
Pour illustrer la lutte que les femmes marocaines mènent, la question de la garde des enfants après le divorce reste un enjeu majeur et souvent chargé d’émotions. Khadija souligne, en s’appuyant sur sa propre expérience, que « la jurisprudence n’évolue pas, et les juges penchent presque toujours en faveur des hommes ». Aujourd’hui, de nombreuses mères perdent la garde de leurs enfants en cas de remariage ou lorsque le père invoque une violation de son droit de visite (articles 174, 175, 176 et articles 184, 185, 186). Ces dispositions suscitent une attention particulière du fait qu’elles ne concernent qu’un seul sexe. C’est pour cette raison que des associations telles que w-lady ou hiya movement continuent de lutter pour l’abrogation de ces articles de la Moudawana qui maintiennent ces règles et contraignent les femmes à choisir entre une vie conjugale et leurs propres enfants après le divorce.
Les voies non-conventionnelles de la libération féminine
Malgré les avancées apportées par la Moudawana, certaines femmes ont choisi de s’émanciper d’une manière non conventionnelle, en s’engageant dans des voies moins orthodoxes pour briser les chaînes de stéréotypes et les attentes sociales.
- La fédération de la sororité à travers l’inclusion professionnelle

En adoptant une approche intersectionnelle, Ghita Skalli indique « qu’une multitude de problématiques autour de l’inégalité des genres relèvent de schémas systémiques que le patriarcat et d’autres systèmes d’oppression ont renforcé ». Il est donc évident, selon elle, que l’inclusion des femmes au Maroc passe d’abord par (1) le démantèlement de ces systèmes qui les maintiennent dans des rôles subalternes – et par (2) leur renforcement personnel, ce qu’elle appelle « l’empowerment ».
En s’engageant dans l’association Mentor’Elles, elle s’est donnée pour but d’aider les femmes à aligner leur carrière avec les valeurs qui les définissent. Elle explique que l’organisation a pour mission « d’accompagner les femmes au niveau de leur réflexion personnelle et de les aider à percevoir que les problèmes qui relèvent de la sphère de l’intime sont en fait universels. ». La question n’est pas de savoir s’il faut permettre aux femmes de travailler, car en réalité, elles ont toujours travaillé, à la différence près que leur travail reproductif, éducatif et domestique n’a jamais été rémunéré ni valorisé, car ayant lieu à l’abri des regards. Ghita l’explique d’ailleurs dans son entrevue : « Tout le système est construit autour du travail gratuit des femmes parce qu’il permet aux hommes d’aller faire un travail rémunéré. Ce mécanisme d’inégalité est pernicieux parce qu’il se passe dans la sphère intime. Et c’est justement parce qu’il se passe dans la sphère intime qu’on a peu conscience du fait qu’il fait partie d’un système généralisé. »
En conséquence, le développement de plateformes comme Mentor’Elles a œuvré à offrir aux femmes un espace d’écoute bienveillant, leur permettant de partager leurs histoires . En leur permettant de se dépersonnaliser de rôles sociaux, de plus en plus de femmes trouvent la motivation pour s’ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles, leur permettant de défier les normes traditionnelles et de poursuivre des carrières ambitieuses. L’importance de fédérer la sororité, pour Ghita, se concentre justement dans cette déclaration : « Quand on se retrouve sous l’emprise d’attentes sociales, on a souvent l’impression qu’il faut se battre seule, et que c’est nous qui n’arrivons pas à accepter certaines règles. Alors qu’en réalité, la société devrait œuvrer à se concerter pour résoudre ce type de problème de manière globale parce que le souci est systémique. »
- La restructuration de l’espace public
« Il y a deux questions qui sont importantes quand on dessine l’espace public pour les femmes : c’est la question de la sécurité et celle du confort. »
Dans son propre parcours professionnel, Ghita cherche à bâtir un espace public plus inclusif. A cet effet, en ouvrant son cabinet d’urbanisme, elle se lance pour objectif de designer une ville qui n’est pas seulement pensée pour les jeunes hommes valides. Elle a pour objectif global que toutes les composantes de la société (les femmes, mais pas seulement), puissent s’y sentir en sécurité et s’investir dans les activités urbaines.
En particulier, elle indique que « quand les autorités et les services de sécurité avec lesquels elle a travaillé lui décrivent les zones à risques, ce qui revient souvent comme expression c’est “fiha ghir rajala” (« on n’y retrouve que des hommes). » C’est en prenant conscience de cela qu’elle fait de sa priorité de construire des infrastructures qui favorisent une représentativité diversifiée – ce qu’elle estime être un gage de développement pour tout un chacun et un critère essentiel pour que les femmes puissent s’épanouir pleinement dans leur société.
- L’éducation comme véhicule de tolérance et de clairvoyance
Professeure depuis plus d’une trentaine d’années, Houda Folleas formule distinctement ce qu’elle reconnait comme sa plus grande ambition : « moi, femme marocaine, mon devoir c’est d’aider les gens à ouvrir leurs esprits ». Observatrice perspicace de la société marocaine, elle cherche à inculquer à ses élèves les notions de tolérance et de liberté parce qu’elle estime que l’égalité des genres passe d’abord par l’intégration de ces deux valeurs là : « par le biais de l’enseignement, tu vas gagner des esprits libres. Et la liberté, c’est de pouvoir être à égalité devant celui qui te la limite. »

Elle considère l’instruction non seulement comme un moyen de forger de jeunes esprits mais également comme un outil puissant pour faire découvrir aux marocains la beauté de leur histoire et de leur identité culturelle. Par le biais de son idéalisme et de cette appréciation qu’elle tient à alimenter, elle amène chaque année des étudiants à vouloir contribuer au développement du Maroc et rendre leur pays plus égalitaire.
A travers les histoires qu’elle enseigne, elle aspire à magnifier cette liberté et à manifester ce sentiment que « les femmes ne sont pas, ultimement, condamnées à être les esclaves du patriarcat ». D’un point de vue factuel, elle cherche aussi à montrer que « les femmes ont toujours eu un grand rôle dans la société marocaine. »
Un des exemples qu’elle utilise pour illustrer ces affirmations est celui de cheikha Kharboucha, qui a lutté contre un caïd en révélant son caractère tyrannique. « Emmurée, elle chantait sans cesse pour réclamer sa liberté et dénoncer son injustice – jusqu’au jour où elle a été enterrée vivante. » À travers ces récits, Houda célèbre les femmes qui se sont battues pour leurs droits.
En parlant de droits, elle explicite qu’il y en a bel et bien au Maroc pour les femmes « il faut juste les connaître (et les faire connaître) parce que le patriarcat lui-même a ses limites ». C’est aussi pour cela qu’elle prend soin de mettre en lumière des événements sociaux actuels comme son témoignage d’une femme qui, arrêtée par un policier, a cité ses droits au commissaire qui lui a donné gain de cause. En ce sens, elle explique justement « qu’au Maroc, quand tu connais bien tes droits, tu peux t’imposer par ta connaissance de ces droits. Quand tu ignores tes droits, tu vis ta vie comme si tu n’en avais pas ».
De manière plus concrète, elle fait transparaitre cette règle avec le cas du harcèlement de rue. Celui-ci a longtemps normalisé par des coutumes intériorisées selon lesquelles l’homme dominant et la femme limitée dans son droit de s’imposer par sa façon d’être (« que ce soit par son accoutrement ou sa posture »). Depuis peu, une loi incrimine certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d’agression, d’exploitation ou de mauvais traitement dans l’espace public. Houda énonce que c’est en prenant conscience des lois, en s’éduquant politiquement et en s’attachant à des idéaux de liberté que l’on œuvrera pour une société plus juste.
- Écrire pour mieux se retrouver
Ayant souffert de la condition féminine et de la perte de son père, Rita El Khayat, (écrivaine, psychiatre, anthropologue a commencé à écrire sur la femme du monde arabo-musulman pour se comprendre dans un premier lieu. Ce travail d’introspection l’a motivée à s’interroger sur sa culture et les rôles sociaux et familiaux que l’on associe aux femmes.
En écrivant extensivement sur les violences traditionnelles faites contre les femmes dans le monde, elle exprime qu’au Maroc, « il y a une violence qui est celle de faire accepter à la femme son statut d’inférieure ». En particulier, elle l’exemplifie avec le fait d’empêcher les femmes de travailler : « la femme devient le bien personnel de l’homme ; elle n’a pas le droit d’avoir une vie extérieure à elle ni de capitaliser par le travail. » A cet effet, elle formule que la violence la plus prédominante dans la société marocaine est une violence de dépendance qui se manifeste à travers le fait de laisser la femme analphabète, de différencier la fille du garçon à tout point de vue dans son éducation et de ne pas lui laisser la liberté de disposer de son corps (« qui appartient d’abord à son père puis a son mari »).
C’est ce cercle de violences symboliques qui justifie majoritairement, aujourd’hui, la résistance aux avancées qui permettrait d’harmoniser la Moudawana et la constitution qui veut une égalité des genres.
Les mécanismes d’adaptation qui en surgissent sont, comme elle l’explique dans son ouvrage les filles de Shehrazade, mal adaptatif. Elle utilise l’analogie de la femme comme « bombe humaine » pour exprimer l’idée que celle-ci fait des enfants (quand elle n’en a pas les moyens) pour se donner une importance sociale et se défende face au patriarche. Elle reste donc condamnée dans son rôle social de mère pour « contrecarrer la mort finalement ».
En priorité, Rita exprime que le chemin pour l’égalité se doit être juridique, philosophique (en termes de capacités et de représentation), économique ainsi que politique – et dans le respect de l’intimité et l’essence de chaque genre. Son exploration de l’universalisme la motive à comprendre la nature féminine – une notion largement étudiée par des hommes tels que Freud (qui ne peuvent pas saisir pleinement l’intimité féminine). Aujourd’hui, elle poursuit cette quête : comprendre ce que signifie être une femme. Elle aspire à permettre aux femmes de se réaliser pleinement dans une société qui les opprime. Selon elle, une harmonie peut émerger si les concepts masculin et féminin parviennent à se comprendre mutuellement. Elle souligne : « C’est dans la paix que nous pouvons construire ; il est temps de penser à un avenir meilleur pour l’humanité, où hommes et femmes s’entraident et poursuivent ensemble le bonheur. »
Une voie fragile et incertaine vers l’émancipation
- L’ambivalence du culte dans le combat féminin
Un volet qui suscite la controverse, plus que tous les autres dans la Moudawana est la question liée à l’héritage. Malgré les lectures théologiques qui tendent vers une équité pleine dans l’héritage, la règle selon laquelle un homme perçoit le double de la part d’une femme dans la succession continue d’entre considérée comme sacrée au Maroc. Même si « la naissance de l’Islam s’est accompagnée de nombreux droits pour la femme (incluant celui d’hériter) », la société du XXIe est bien différente en ce qui concerne le partage des responsabilités familiales. La question de réinterpréter le Coran selon notre ère actuelle se pose donc.
Au symposium africain, organisé avec l’association w-lady, ont été invités des théologiens qui ont décrété que la réforme des questions du divorce et de la garde ne contredisent en rien la liberté de culte. Mais beaucoup de Marocains plus conservateurs utilisent l’argument religieux pour aller à l’encontre des réformes de succession. Plus surprenant encore, « 2000 femmes de partis islamistes sont sorties lutter contre ces droits, contre les changements dans la Moudawana qui les avantageait dans ce domaine-là. »
Il n’est cependant pas vain pour les progressistes de rester optimiste, car, dans son discours du Trône prononcé en fin juillet 2022, le roi Mohammed VI a ouvert la voie à une révision du Code pénal et de la Moudawana pour instaurer davantage d’égalité entre les hommes et les femmes.
- Une réalité sociale complexe
En interrogeant Ali Benkirane, réalisateur du court métrage Amal, de nouveaux facteurs oppressifs ont été identifiés au dépend de l’émancipation féminine. À travers le personnage d’Amal, le réalisateur illustre le combat quotidien que de nombreuses jeunes filles marocaines doivent mener pour accéder à l’éducation. Sa marche matinale vers l’école symbolise la ténacité face aux obstacles géographiques et socioculturels, un voyage métaphorique vers la connaissance et l’indépendance.
Cependant, le défi majeur se présente lorsque les parents d’Amal décident de mettre fin à son éducation. Ce tournant dramatique reflète les tensions entre tradition et aspirations individuelles, ainsi que les complexités auxquelles les femmes et les filles sont confrontées pour défendre leur droit à l’éducation et à l’autonomie. Cette partie du récit fait écho aux lacunes du système juridique pré-Moudawana et souligne les sacrifices que les femmes font pour surmonter les entraves à leur épanouissement.
Bien que le film ne soit pas explicitement conçu comme un manifeste féministe, il offre une perspective éclairante sur la gestion des talents et le déficit d’infrastructures éducatives au Maroc. Ces problématiques s’entremêlent de manière subtile avec les nuances du patriarcat, créant une toile complexe qui influence la trajectoire de jeunes enfants ruraux comme Amal partout dans le Maroc. Cette subtile exploration des enjeux féminins révèle comment les systèmes éducatifs défaillants et le patriarcat sont intrinsèquement connectés, contribuant ainsi à l’oppression des femmes et à la sous-utilisation de leurs talents. En somme, le film souligne que les problèmes d’éducation et de gestion des talents ne sont pas uniquement des problèmes de genre, mais sont profondément enchevêtrés avec les structures patriarcales et culturelles, créant ainsi une perspective nuancée sur le chemin vers l’égalité et l’émancipation.
En somme, l’histoire des femmes au Maroc reflète une lutte acharnée pour briser les entraves de la dépendance et de l’inégalité. Longtemps reléguées au statut de mineures légales, les femmes ont affronté des obstacles sociaux, culturels et juridiques étouffants.
Cependant, des voix intrépides ont émergé pour défier l’ordre établi. Des femmes ont tracé des voies non conventionnelles vers l’émancipation, avec des mouvements féministes et des associations prônant l’éducation et l’autonomisation.
Les réformes audacieuses de la Moudawana ont déverrouillé des portes autrefois closes, ouvrant la voie à plus d’égalité dans l’éducation, l’emploi et la sphère publique. Cependant, des obstacles subsistent, notamment des lacunes légales et des interprétations rigides de la tradition.
La voie vers l’égalité totale reste incertaine, mais les succès de femmes déterminées ponctuent le chemin. Les initiatives renforçant la solidarité féminine et offrant des opportunités professionnelles contribuent à forger un avenir plus équitable.
Feature photo is of women’s wear on display – Tangier – Morocco. Photo: Adam Jones. CC3.0
The Upstream Journal is recognized by Feedspot as one of the top human rights magazines as well as one of the top magazines about social justice on the web.